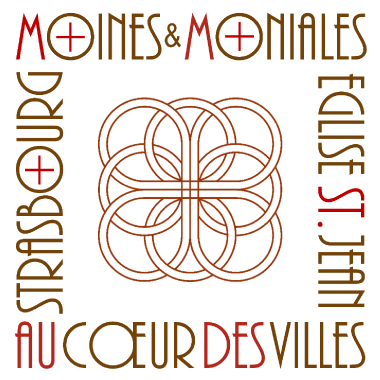La parabole que Jésus raconte aux pharisiens est vraiment très dérangeante…
Très dérangeante parce que, tout comme ça a été le cas pour les pharisiens,
on ne peut l’entendre sans se sentir concerné.
Il y avait un homme riche.
Cet homme reste anonyme.
On ne nous dit rien de lui ; il n’est pas dit qu’il soit mauvais ou méchant.
Il n’a qu’une caractéristique : il est riche ; il vit luxueusement et dans l’abondance.
Le pauvre, lui, porte un nom : Lazare.
Le récit ne fait en rien l’éloge de Lazare,
il n’est pas dit qu’il soit spécialement bon, vertueux ou croyant.
Non, Lazare est pauvre, voilà tout.
Le riche et le pauvre n’ont rien en commun,
sinon que Lazare est couché devant le portail du riche ; donc ils vivent l’un à coté de l’autre.
Ah si ! ils ont aussi en commun qu’ils vont mourir tous les deux.
A la manière dont il raconte son récit,
Jésus développe soigneusement deux caractéristiques de la parabole qui sautent aux yeux :
d’une part, il ne moralise pas :
il ne fait pas l’éloge d’un bon ni ne condamne un méchant ; il semble plutôt décrire un mécanisme.
d’autre part, dans son récit, tout conduit l’auditeur à devoir se considérer du coté du riche,
et tout l’oblige à voir le pauvre à coté de lui en restant impuissant.
En écoutant la parabole, pas de doute : le riche, c’est moi, aujourd’hui.
Je passe à longueur de jour devant des pauvres qui vivent dans la rue.
Je vis dans la même ville, et pourtant un grand abîme nous séparent :
je ne sais pas comment me comporter, ni comment aider, ni entrer en relation.
Ce grand abîme est comme un mur de séparation qui rend impossible la rencontre et le partage.
Riches et pauvres se trouvent dans deux mondes étanches.
Ce qui se vivait déjà du temps de Jésus, ou du temps du prophète Amos,
nous le vivons de manière aiguë aujourd’hui dans nos villes.
Et voilà pourquoi cette parabole, d’emblée, a de quoi nous mettre terriblement mal à l’aise :
c’est comme si elle nous présentait un miroir pour que nous prenions conscience de notre vie.
Ayons un peu de courage : acceptons de nous laisser déranger par Jésus.
Car il n’a pas terminé. Il continue sa parabole :
Jésus décrit alors le principe du retournement des situations ;
on le trouve déjà déjà dans le discours des Béatitudes :
Heureux, vous, les pauvres car le Royaume de Dieu est à vous,
Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation. (Luc 6, 20.24)
Dans la parabole, le pauvre Lazare meurt
et les anges l’emportent auprès d’Abraham pour qu’il trouve le bonheur.
Le riche meurt, on le descend en terre,
et au séjour des mort, il est en proie à la torture et à la souffrance.
Abraham lui dit : Tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur ;
Maintenant, il trouve ici la consolation, et toi, c’est à ton tour de souffrir.
Voilà donc que l’abîme se prolonge jusque dans l’au-delà.
Mais désormais, le riche devient pauvre et souffrant, et sa situation devient sans issue pour toujours.
Le prophète Amos annonce lui-aussi cette impasse dans la première lecture :
Malheur à ceux qui vivent bien tranquille (…) et qui se croient en sécurité (…).
Maintenant, ils vont être déportés ; et la bande des vautrés n’existera plus.
Le psalmiste dit aussi (ps 48) :
L’homme dans son luxe ne comprend pas, il ressemble au bétail qu’on abat.
Arrivés à ce stade du récit, on assiste alors à un dialogue entre le riche et Abraham.
A noter que décidément, jamais le riche ne parle directement à Lazare.
Le riche supplie qu’on aille avertir ses frères.
On se dit : bon, il a quand même bon cœur…
On voudrait tant lui trouver des circonstances atténuantes.
Abraham répond qu’ils sont déjà avertis : ils ont la loi de Moïse et les prophètes.
Il n’y a pas qu’Amos, en effet : tous les prophètes dénoncent sans cesse l’injustice.
Quant à la Loi de Moïse, elle déclare explicitement dans le Deutéronome :
Se trouve-t-il chez toi un malheureux ? Tu n’endurciras pas ton cœur.
Je te donne ce commandement : tu ouvriras tout grand ta main
pour ton frère quand il est pauvre et malheureux dans ton pays. (Dt 15,7.11)
Donc tout est déjà dit. Quel signe faudrait-il encore ?
A ce stade, et puisque Jésus ne fait pas la morale,
on commence à comprendre qu’il est plutôt en train de dévoiler l’aveuglement et la paralysie
et ce qui y conduit.
Il s’adresse à des aveugles qui ne veulent pas voir,
à des paralysés incapables d’agir.
La parabole de Jésus semble ainsi dévoiler notre condition :
nous sommes riches, mais en réalité nous sommes les plus à plaindre
tant la parabole découvre notre incapacité à aimer et la fermeture qui en est la conséquence.
Englué dans le confort, nous sommes empêchés de nous engager franchement pour la justice.
Pour la plupart, nous voudrions être généreux,
nous voudrions rompre cet abîme qui nous sépare des pauvres.
Mais nous ne savons pas faire, prisonniers de la peur, de la confusion, de la paralysie…
Les vrais pauvres, c’est nous.
C’est alors que tombe la dernière phrase de la parabole, un peu comme une sentence :
S’ils n’écoutent pas Moïse ni les Prophètes,
quelqu’un pourra bien ressusciter d’entre les morts : ils ne seront pas convaincus.
Ressusciter d’entre les morts… Évidemment, à ce moment, Jésus parle de lui.
Il est en train de dire que celui qui est incapable de voir les pauvres,
ne sera pas davantage capable de l’accueillir lui-même dans sa résurrection.
Ne serait-ce pas la pointe de son message ? Le pauvre, le pauvre par excellence, c’est le Christ.
Le pauvre souffrant, rejeté, ignoré, abandonné, c’est le Christ.
Ce que vous avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.
Vous aurez toujours des pauvres dans le pays, dit le livre du Deutéronome.
Le pauvre est un scandale ; mais ne serait-il pas aussi un don de Dieu ?
Dieu nous envoie des pauvres pour nous aider, pour soigner nos aveuglements et nos paralysies.
Et dès lors, ce sont les pauvres qui deviennent nos médecins. Ils sont notre remède.
Si je découvre que le malade, c’est bien moi,
que celui qui a besoin d’être guéri et sauvé, c’est d’abord moi,
alors mon regard sur le pauvre peut commencer à changer.
Ma prière peut commencer à se transformer. Mon cœur blessé se transforme.
Je ne supplierai pas seulement le Seigneur d’aider ces pauvres gens qui n’ont rien,
mais je commencerai par supplier Dieu qu’il vienne à mon aide,
moi pécheur et incapable d’une vraie solidarité,
incapable de rencontrer celui que Dieu met à ma porte comme un autre lui-même.
Or si je me reconnaît comme le vrai pauvre qui a besoin d’aide, alors me voilà sauvé.
Dieu ne nous envoie-t-il pas les pauvres pour briser notre cœur et nous reconnaître pêcheur ?
Ne devrons-nous pas allez vers les pauvres pour leur demander qu’ils nous guérissent ?
En réalité, seule l’expérience de la croix peut faire de nous ces pauvres de cœur
capables de devenir frères de tous ;
pas seulement généreux ou solidaires, mais pauvre de cœur pour devenir frère de tous.
Celui qu’annonçait la Loi et les prophètes, c’est le Christ.
Le Christ vient nous sauver de ce mur de séparation.
Et pour cela, il doit transpercer nos cœurs par sa croix.
Il se présente à nous comme un SDF, un malade mental, un chômeur désespéré…
pour que nous l’accueillons et qu’il nous sauve.
L’Église a raison de dire que l’évangile comporte une option privilégiée pour les pauvres.
Par la parole de Jésus, puissions-nous devenir ces pauvres
qui ont tant besoin des autres pour rencontrer leur Seigneur et marcher à sa suite.
Heureux, vous les pauvres, car le Royaume de Dieu est à vous. (Lc 6, 20)